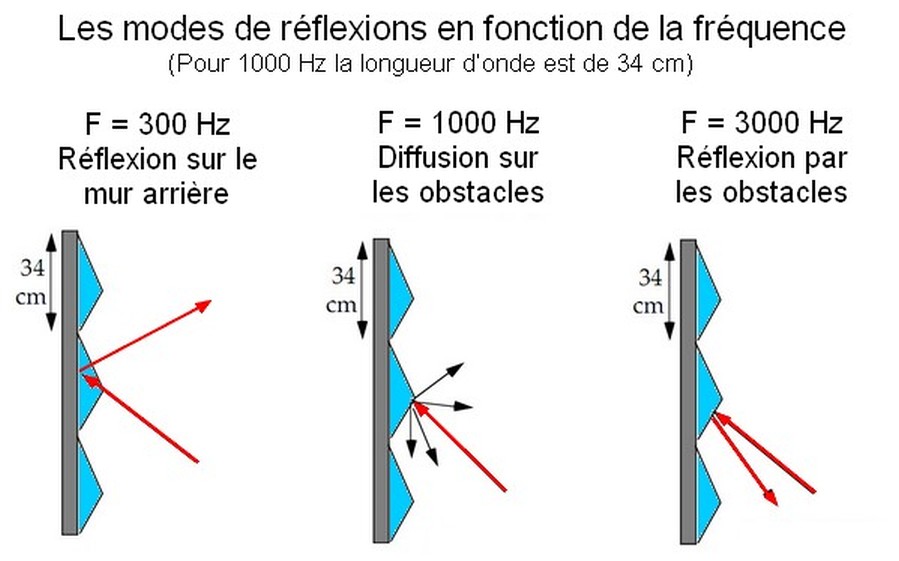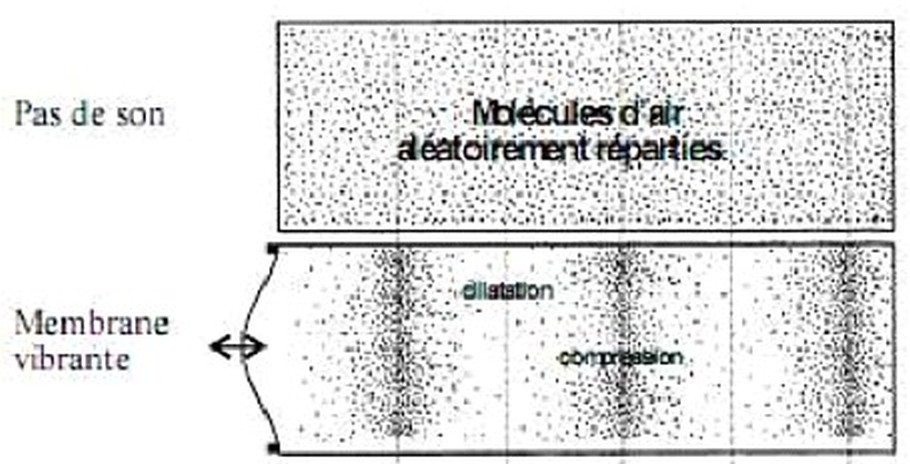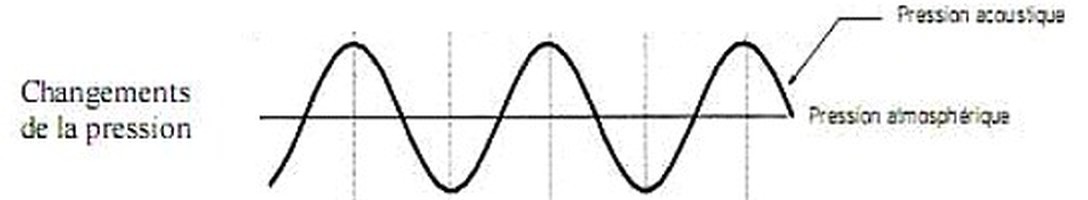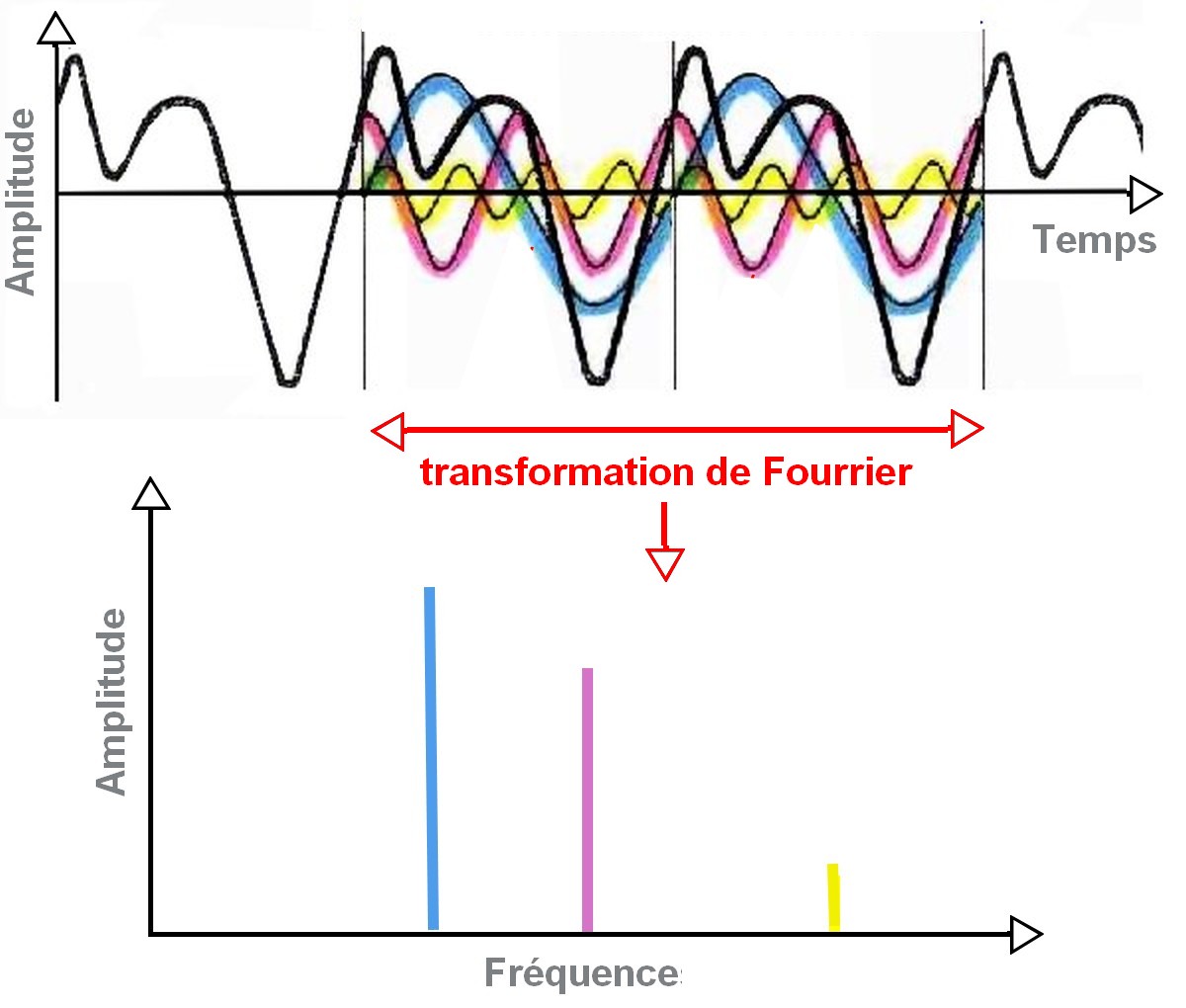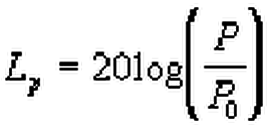|
|

Définitions

|
 Le son (Définition) Le son (Définition)
Le son est une sensation
auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air.
L’origine de cette variation est engendrée par la vibration d’un corps
qui met en vibration l’air environnant (éventuellement un liquide ou un
solide).
Les vibrations sonores se propagent par transfert d’énergie de
particules à particules adjacentes, le son ne se propage donc pas dans
le vide, il a besoin d'un support matériel comme l'air, l'eau, le métal
(etc.).
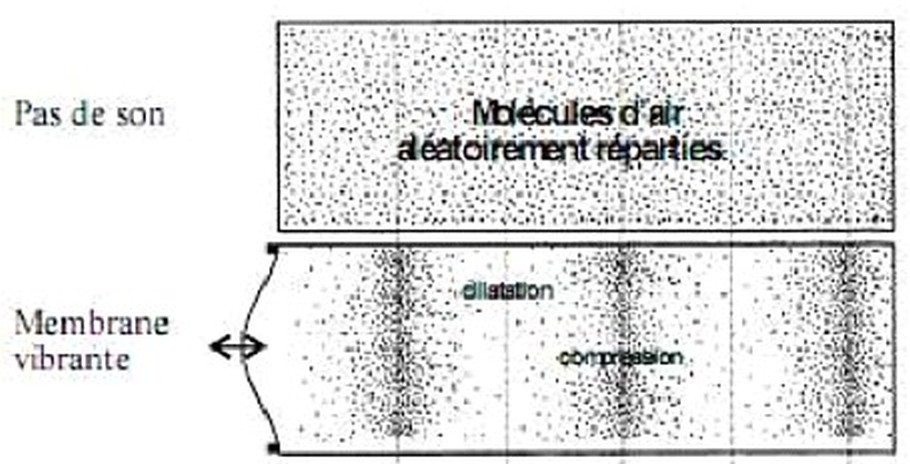
C’est la succession de zone de pression et de dépression qui
constitue l’onde acoustique. Quand cette onde arrive à
l’oreille, elle fait vibrer le tympan, le son est alors perçu.
 La vitesse du son (en mètre / seconde > m/s) La vitesse du son (en mètre / seconde > m/s)
La vitesse du son dans
l'air est de 340 m/S à 20 °C, elle varie avec la température et tombe à
331 m/s à 0 °C, la pression atmosphérique n'a pas d'influence sur sa
vitesse. La vitesse dépend aussi de la nature du matériau qui
transporte ce son:( à 20 °C dans l'acier > 5000 m/S, le bois > 550
m/S, l'eau > 1435 m/S, le verre > 6000 m/S)
 Un son pur Un son pur
C'est un son correspondant précisément à
une variation sinusoïdale de la pression de l'air en fonction du temps.
Ce son n'existe pas vraiment dans la nature, seul des appareils
spécialement conçus pour cet usage permettent de produire un tel son.
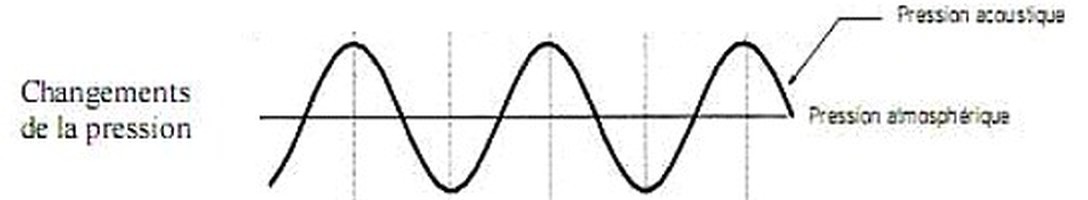
Un son pur se caractérise
par sa fréquence sa longueur d’onde et son intensité.
 La fréquence (en Hertz > Hz) La fréquence (en Hertz > Hz)
Le Hertz (Hz)
défini le nombre d'oscillations par seconde : Si en un point donné la
pression fluctue 500 fois par seconde autour de la pression
atmosphérique (une fois dessus et en dessous) il à une fréquence de 500
Hertz.
 La période (en seconde > s) La période (en seconde > s)
Pour une onde régulière,
c’est l’intervalle qui sépare deux passages par zéro dans le même
sens. La période (en seconde) : Avec 100 fluctuations par seconde (100
Hertz) la période est de 1/100 de seconde soit 10 mS. Plus la période
est longue, plus la fréquence est basse et le son est grave,
inversement, plus la période est courte plus la fréquence est élevée et
le son est aigu.
 La longueur d'onde (en mètre > m) La longueur d'onde (en mètre > m)
La longueur d’onde est la
distance parcourue par une onde sonore pendant la durée d’une période.
On la calcule en divisant la vitesse du son (340 m/S dans l'air à 20
°C) par la fréquence (en Hz). La note LA (440 Hz) à une longueur d’onde
de 77,27 cm, le son le plus grave produit par certaines grandes orgues
est de 16 Hz et à une longueur d’onde de 21,25 m, par contre un son de
20 kHz à une longueur d’onde de 17 mm seulement.
 Le son complexe Le son complexe
C'est le cas de presque
tous les sons. Un son complexe peut être décrit comme la somme de
nombreux sons purs ayant entre eux des rapports de niveaux, de
fréquences et de temps. Une méthode mathématique appelée transformation
de Fourrier permet de décomposer exactement un son complexe obtenu par
la mesure en ses différents composants
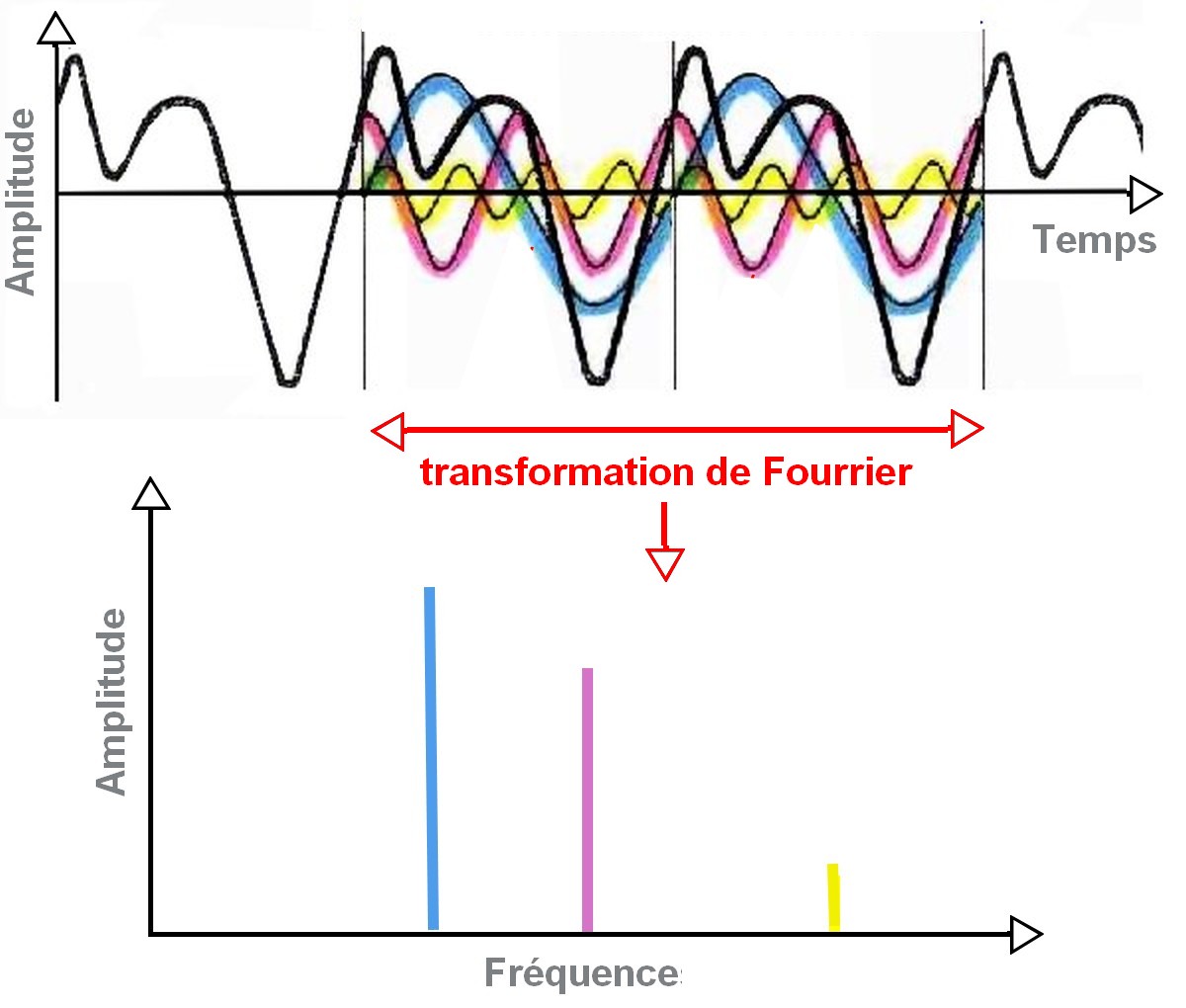
 Fondamentale et harmoniques Fondamentale et harmoniques
Quand un son unique est
produit, la décomposition de ce son en sons purs montre que les
fréquences de toutes ses composantes ont entre elles des rapports
précis. La fréquence la plus basse est appelée la fondamentale, les
autres sont les harmoniques et ont des fréquences multiples de la
fondamentale (en bleu sur le dessin ci-dessus). Pour nos oreilles les
harmoniques paires (multiple 2, 4, 6 etc.) donnent une sensation de
douceur, les harmoniques impaires produisent un son plus acide. C'est
la richesse et l'infinie combinaison des harmoniques qui donnent un
timbre particulier à chaque son.
 Le timbre sonore Le timbre sonore
Le timbre d'un son dépend
de sa composition du son, c'est la sensation auditive due au nombre, à
l'amplitude et à la répartition des harmoniques par rapport à la
fréquence fondamentale. Le départ du signal sonore (l’attaque) a aussi
une grande influence sur la sensation du timbre.
 Le niveau sonore (en Pa ou dBA) Le niveau sonore (en Pa ou dBA)
La pression acoustique
d’un bruit est mesurée en PASCAL (Pa). L’oreille est sensible à des
pressions allant de 0.00002 Pa à 20 Pa, soit un rapport de 1 à 1 000
000.
Pour ramener cette large échelle de pression, exprimée en Pascal, à une
échelle plus réduite et donc plus pratique d’utilisation, on a adopté
la notation logarithmique et créée le décibel (dB) plus représentative
de la sensibilité de nos oreilles. Un doublement de la pression
acoustique équivaut à une augmentation de 6 dBA, un décuplement à 20
dBA etc..
 La loi de Weber - Fechner La loi de Weber - Fechner
|
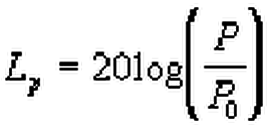
|
Lp est
exprimé en dB, P est exprimé en Pa,
P0 est la pression de référence = 20 millionièmes de Pa
(Une pression de 1 Pa
représente 94 dB)
|
Pour information voici quelques
exemples de niveaux sonore

Il en va de même lorsque l’on exprime une variation la puissance
fournie par un amplificateur à une enceinte acoustique, Vous
trouverez plus d'explication à la page Puissance et Décibels.
 Transmission des sons en champ libre Transmission des sons en champ libre
Lorsque l'auditeur
s'éloigne de la source, le niveau acoustique s'atténue de 6 dB chaque
fois qu'il double la distance le séparant de la source (l'énergie est
divisée par 4). L’onde sonore sphérique se propage de façon homogène,
on dit que la source est omnidirectionnelle
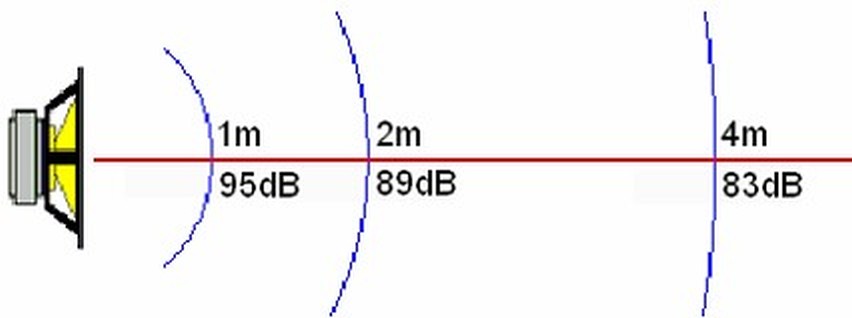
On calcule cette
atténuation par la formule suivante:
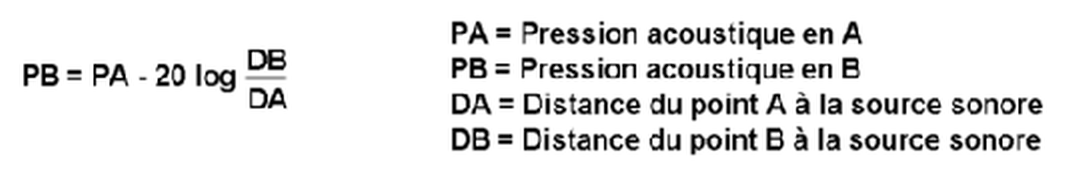
 Réflexion sur un
obstacle Réflexion sur un
obstacle
Un obstacle suffisamment rigide
et lourd réfléchi un son comme un
miroir réfléchi la lumière, pourvu que les dimensions de l’obstacle
soient plus grande que la longueur d’onde de ce son.
Mais lorsque la surface de cet
obstacle présente des irrégularités d’une taille comparable à la
longueur d’onde du son est diffusé un peu dans toutes les directions.
Pour les fréquences encore plus
élevées il y a de nouveau réflexion mais la direction dépend de la
forme de la surface.
A partir de là, vous estes prêt
pour lire la page L'acoustique
du local

 |
 |
 |
 |
Home
|
Haut
|
Précédent
|
Suivant
|
|

 Transmission des sons en champ libre
Transmission des sons en champ libre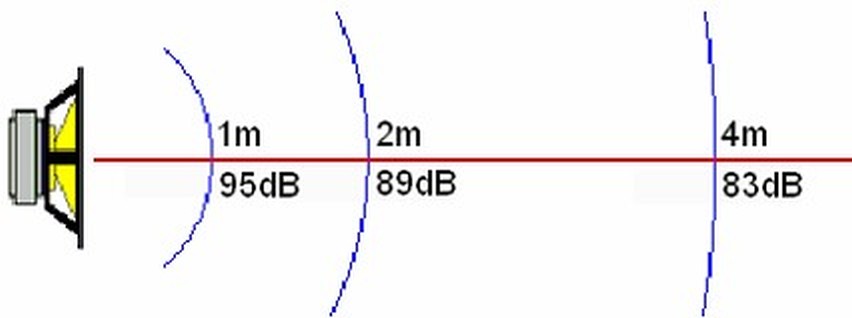
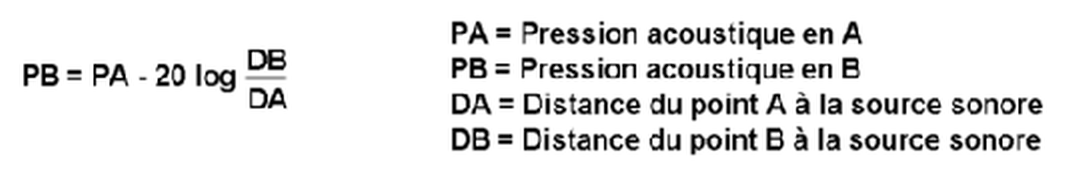
 Réflexion sur un
obstacle
Réflexion sur un
obstacle